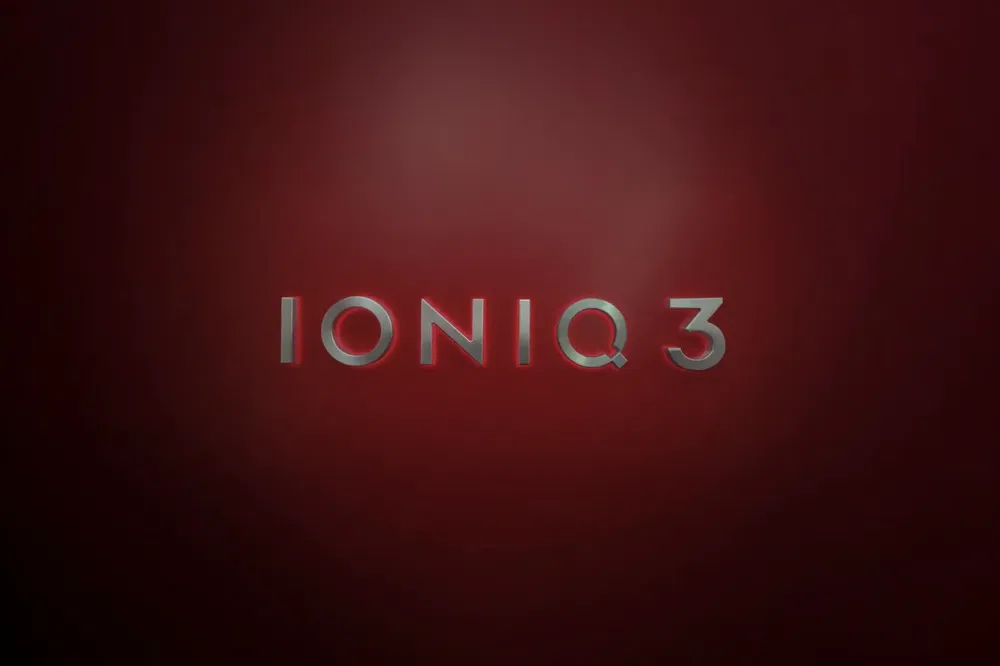Leur rôle est de contrôler la vitesse moyenne sur une distance plus ou moins longue pour déceler les excès de vitesse.
Le principe du radar-tronçon est de détecter les plaques d’immatriculation entre deux caméras ANPR pour définir la vitesse du véhicule sur base du temps de parcours. Si elle dépasse la limitation, et la tolérance technique, le système signalera automatiquement l’excès de vitesse. La police locale ou fédérale pourra alors envoyer un PV au propriétaire du véhicule. C’est rudement efficace et les conducteurs le savent en étant plus prudents dans les zones concernées. Pour fonctionner, ces radars-tronçons doivent être reliés à la base de données des immatriculations des véhicules belges pour faciliter la verbalisation. Pour les conducteurs étrangers, il faut une opération supplémentaire via une requête au système EUCARIS pour obtenir leur identité. Cette action est même automatisée avec les pays limitrophes et pratiquement tous les pays de l’Union européenne (mais pas le Danemark) dans le cadre de la directive européenne 2015/413. La Belgique peut aussi signer des accords bilatéraux d’échanges d’informations avec des pays hors de l’U.E.

Un peu partout
Au départ, en Belgique, ce type de radar était installé sur certains tronçons autoroutiers, dont les tunnels. Les radars-tronçons se sont ensuite généralisés sur les autoroutes flamandes puis wallonnes, ainsi que dans les tunnels bruxellois. On en trouve également sur des routes nationales et régionales, et même sur les voiries communales. Les caméras ANPR utilisées doivent répondre à des critères juridiques bien précis, comme pour les caméras de surveillance. D’ailleurs, les zones surveillées par les radars-tronçons sont toujours signalées. Or, à Grimbergen, leur installation pose un problème de protection de la vie privée. Car ces caméras intelligentes peuvent aussi filmer les piétons et les cyclistes. Ce qui remet en cause leur utilisation au sein d’une commune ou dans une zone avec une forte densité d’usagers faibles. L’affaire est toujours en justice en mai 2025, sans que l’on sache encore si cette ville pourra utiliser son réseau de surveillance. Une situation d’attente qui peut aussi bloquer les autres communes.
Saturation
Un autre problème est survenu avec la multiplication des dispositifs le long de nos routes. Depuis mai 2023, il ne serait plus possible de connecter de nouvelles caméras ANPR à la base de données centrale. Ce qui impose une étape supplémentaire pour l’identification des contrevenants. De plus, le système se déconnecte parfois à cause du nombre trop élevé de requêtes liées aux 10.000 caméras installées depuis 2016, notamment pour lutter contre le terrorisme. Un problème général qui gêne également le fonctionnement des radars-tronçons dédiés au contrôle de la vitesse. Dès lors, près de 60 % des zones de police du pays n’auraient pas été connectées au fichier central. De plus, il y a une prolifération de bases de données locales. Bref, même s’il faut bien évidemment rester prudent dans une zone surveillée, rien de dit si le passage devant la caméra aboutira ou pas à un P.V. en cas d’excès d’enthousiasme avec la pédale de droite.